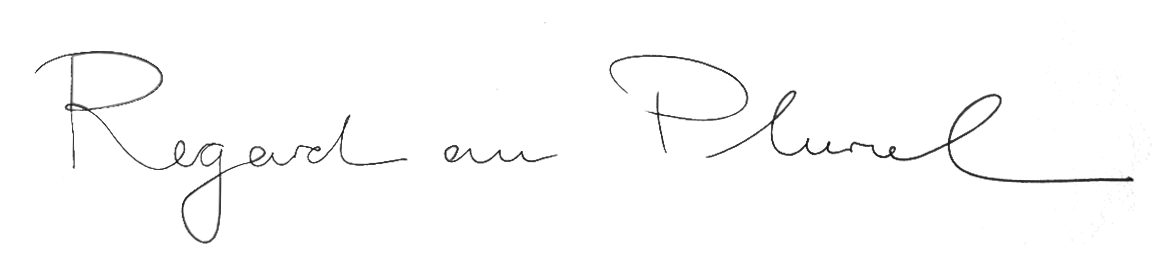Eduardo Arroyo Alberto Giacometti
Eduardo Arroyo Alberto Giacometti
Entretien
Eduardo Arroyo
« Il ne reste rien de ce à quoi je croyais »
Le peintre et écrivain espagnol publie « Minutes d’un testament », sorte d’autobiographie décalée et sans concession.
Vous affirmez que Giacometti vous a dit qu’il voulait que sa sculpture, L’homme qui marche, rivalise avec l’image qui orne les étiquettes de whisky Johnny Walker. C’est une généalogie inattendue pour une oeuvre si célèbre.
Il avait raconté ça au sculpteur Raymond Mason, dans un bar de la rue Delambre, le Rosebud. Devant l’étiquette de la bouteille, il a dit : « voilà une sculpture qui marche », ou quelque chose comme ça. Et quand on regarde son attitude, c’est vrai que c’est ça. Et c’est un mot très drôle.
Néanmoins, c’est un très mauvais whisky…
Ah non, je dois le défendre ! C’est le plus blanc de tous. Les bons whiskys sont un peu brûlés, je le sais, un peu fumés… Je ne les aime pas du tout. Moi, je les veux comme de l’eau, très clairs.
En dehors du whisky, qu’est-ce que Giacometti vous a appris ?
J’ai eu la chance d’avoir 20 ans à Paris, et de vivre à Montparnasse, un quartier d’artistes à l’époque. Paris était divisé en deux : les artistes à Montparnasse, les écrivains à Saint-Germain. Ce que je voyais, c’était le comportement des peintres, leur noblesse, malgré une misère très grande. Les vieux avaient un regard sur nous, les jeunes. Ils se donnaient la peine d’aller voir dans les galeries, et de repérer des jeunes. « Venez avec nous, on va continuer à vivre ensemble… » C’était ce qu’ils avaient vécu eux-mêmes. Une tradition qui rejaillissait jusque dans les galeries où les vieux faisaient vivre les moins vieux, qui eux faisaient vivre les jeunes.
Pour l’art, Giacometti ne m’a pas apporté grand-chose, pas plus que Picasso. Mais j’avais un énorme intérêt pour eux comme pour Léger : pour ce qu’ils étaient. Picabia aussi m’a apporté quelque chose. Je ne l’ai jamais rencontré, mais j’avais accompagné mon premier marchand à l’Hôtel Drouot, où on voyait passer des tableaux de Picabia qui n’intéressaient personne à l’époque. Lui en achetait de temps en temps, et il me parlait de Picabia. Je dois quelque chose à Max Ernst, et à Derain, qui est le grand peintre pour moi.
Giacometti, c’était le comportement. S’il avait de la sympathie pour moi, c’est parce qu’il avait vécu avec beaucoup d’engagement la guerre civile espagnole, mais il ne savait pas que j’étais artiste. Je ne lui ai jamais dit. Je n’osais pas. Il y avait un respect qu’on n’imagine pas aujourd’hui, avec ces conneries qui sont venues ensuite, cet art « émergent » qui ne danse qu’un été, avec la complicité d’une bande de types qui ont perdu la cervelle, galeries, curateurs, bureaucrates.
Le monde artistique actuel est répugnant, un Barnum insupportablement idiot. Et l’Etat, alors, ne s’occupait pas d’art. Cette idée de l’artiste, qui m’a accompagné toute ma vie, est aujourd’hui complètement cassée. Il ne reste rien de ce à quoi je croyais, cette succession de générations qui ne s’arrête jamais, cette manière d’aborder l’art…
Vous-même, vous aidez les jeunes artistes ?
Non. Je déteste les jeunes. Eux, et ils ont raison, me détestent aussi. Ou pire, ils m’ignorent totalement. Et je suis devenu un vieux con, parce qu’en plus, je continue à peindre à l’huile ! Ce qui m’amuse le plus, c’est les déjeuners avec les confrères. Mais on est une bande de retraités, candidats au Père-Lachaise.
Cette succession s’est cassée quand ?
Entre 1963 et 1968. En 68, c’était fini. C’est pour ça que Gilles Aillaud, Antonio Recalcati et moi avons peint en 1965 Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp. On a lu dans l’hebdomadaire Arts une enquête pour savoir qui était le plus important dans l’histoire de l’art, Picasso ou Duchamp. Duchamp a gagné haut la main. On s’est dit merde ! Gilles, qui était le maître-penseur du groupe, nous a décidés à le tuer. Pas l’homme, mais le théoricien d’une façon de se comporter – celui de la dérive qu’il a donnée, d’une façon je dois dire absolument géniale, à l’art. A partir de ça, les choses se sont précipitées.
Mais il y a des gens qui continuent à peindre. Et même à l’huile !
C’est vrai. Il y a toujours des gens qui sont saisis par le démon, et qui peignent. Mais j’ai l’impression de revoir des copies du Nouveau Réalisme ou du Pop Art. Avec un peu de surréalisme aussi, des objets insolites, des conneries comme ça.
Vous citez beaucoup dans votre livre Paul Rebeyrolle.
Il m’a fait entrer dans sa galerie et aidé à exposer. Il s’est débrouillé toute sa vie pour être très indépendant, sans vendre de tableaux, tout en étant chez les plus grands marchands. J’avais beaucoup d’admiration pour lui et sa peinture, mais c’était un homme étrange. Très grand artiste, mais pas un intellectuel.
Son voyage à Cuba l’a perturbé. Il s’est mis dans les mains de ceux qui gravitaient autour de la revue Les Temps modernes et à faire de la peinture engagée, avec les oiseaux qui représentaient les forces du mal, les sauveurs qui étaient les Cubains, des idioties. Pourtant, il peignait avec une subtilité, une délicatesse… C’était un Falstaff, violent et sanguin, avec des tableaux magnifiques ! Toute la série des Truites…
Vous citez des philosophes comme Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832)…
Un proto-marxiste, un proudhonien… qui a beaucoup influencé le grand-oncle de mon épouse Isabel, Gumersindo de Azcararte (1840- 1917), un homme de bien qui avait fondé la Residencia Estudiantes où sont passés Llorca, Buñuel et compagnie et luttait pour une école laïque et libérale. Il a publié en 1876 Minuta de un testamento, qui est aussi le titre de mon livre. Il m’a servi de trait d’union pour faire ce livre. Je suis un fou de testaments – j’en ai fait déjà plusieurs – mais les siens étaient merveilleux. Il léguait des possessions qu’il n’avait pas à des enfants qu’il n’avait pas…
Il y a un beau paragraphe sur le sang chez Le Caravage.
Quand les gens écrivent sur la peinture, c’est toujours pareil. Ce sont des gens savants, qui apportent beaucoup, mais pour la plupart un peu trop de littérature quand ils parlent de mythologie ou d’histoire. Peu parlent de peinture. Moi, je crois que je peux. Il faut parler de la peinture ! Quand Vélasquez donne l’impression d’avoir pris un pot de peinture rouge, un carmin ou quelque chose comme ça, et vlan !, le balance sur le corps de son matador, c’est comme un dripping à la Pollock.
Vous évoquez aussi un écrivain, G. W. Sebald.
Un grandissime écrivain. J’ai lu tout. Il y a beaucoup de drôlerie et de poésie. Les Emigrants [disponible en « Folio » Gallimard], c’est un livre magnifique ! J’ai beaucoup regretté la mort de ce type-là. Une littérature magnifique, une littérature du vagabondage, je trouve ça formidable.
Vous avez aussi parfois des phrases vaches. Parlant de Twombly à Rome : « Je crois qu’il n’est jamais allé bien loin. Il connaissait Romulus et Remus parce qu’ils étaient du voisinage pour ainsi dire, mais pas davantage. »
Je suis très partagé sur sa peinture. J’ai vu de très beaux tableaux de sa première époque, mais aussi une salle imbuvable dans un musée de Zürich.
Et Gilbert et George ?
Alors là, non, ce n’est pas possible ! [Suit un commentaire impubliable.]
L’Espagne est, elle aussi, assez mal traitée dans le livre.
La France aussi. Ce sont des pays que j’aime beaucoup.
Propos recueillis par Harry Bellet et Philippe Dagen
Photos Ernst Scheidegger
Tous droits réservés